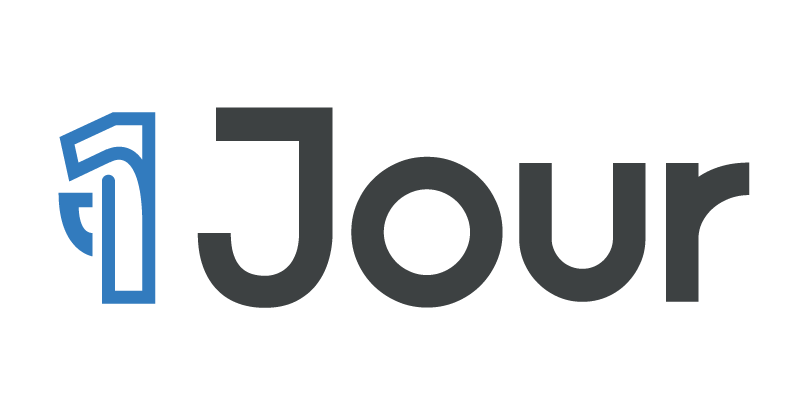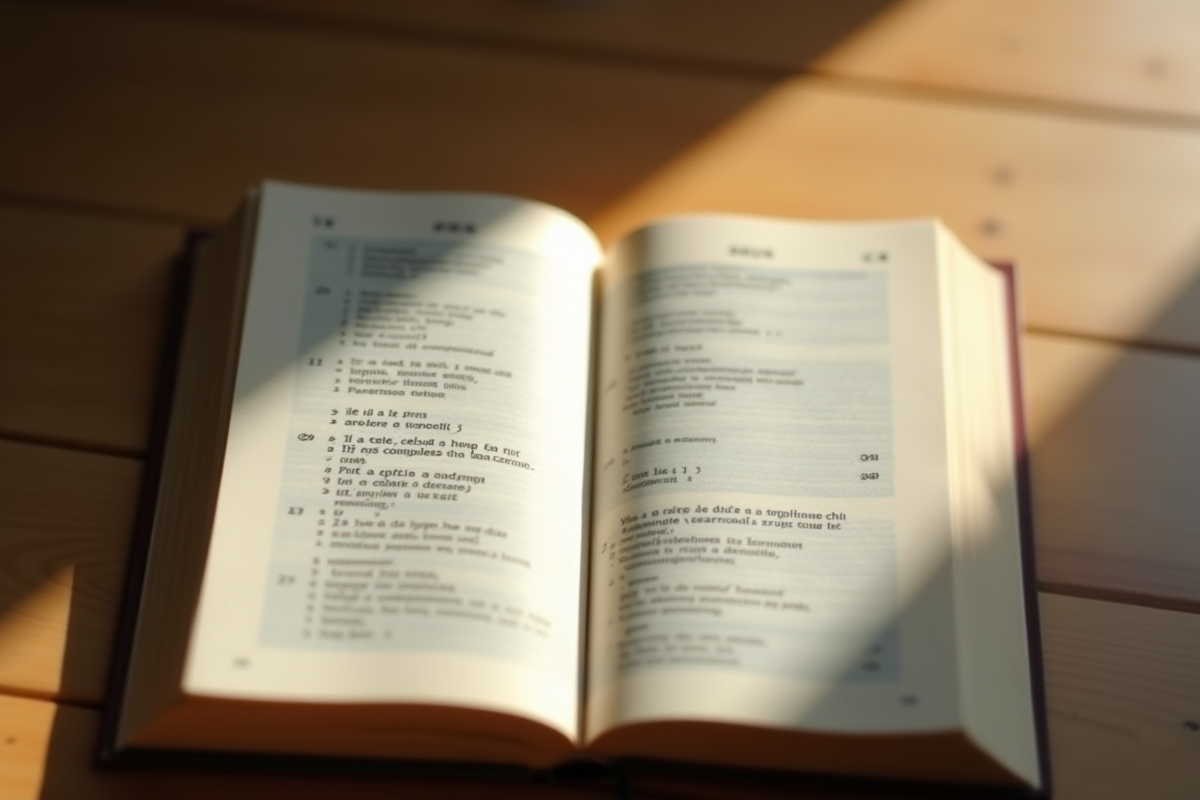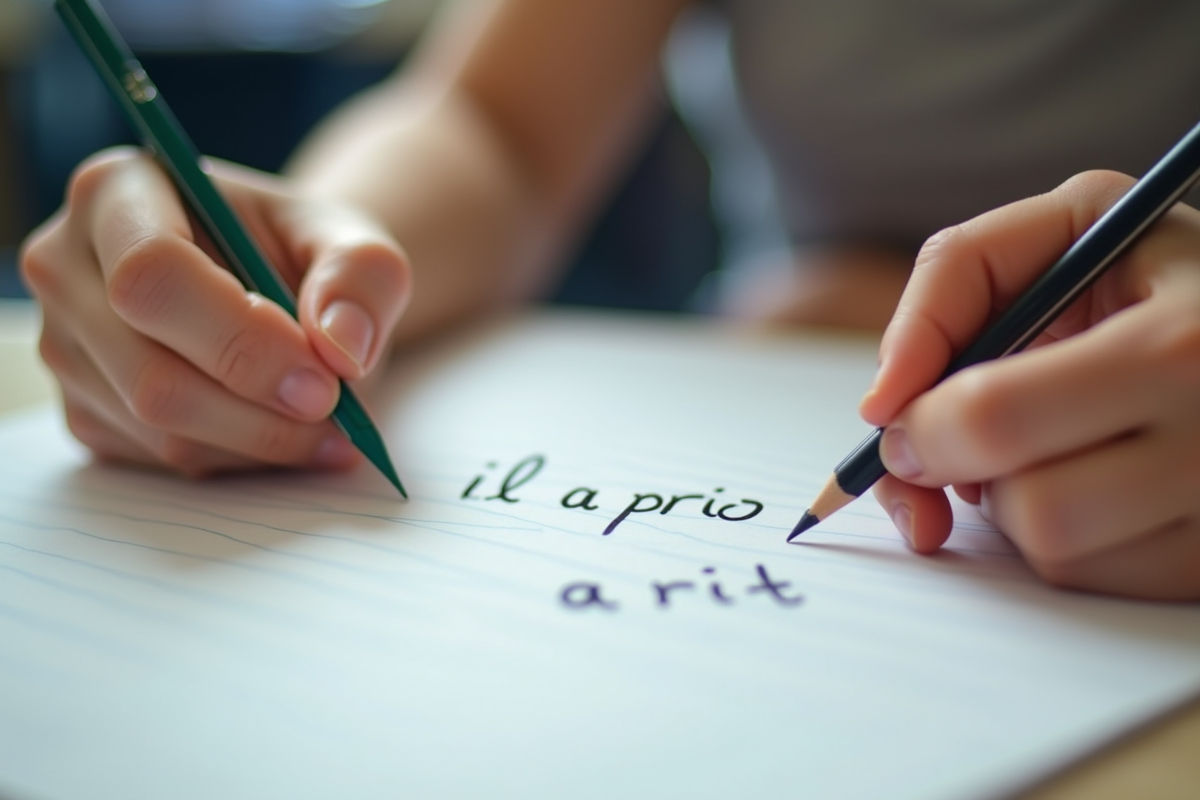Une confusion tenace persiste autour de la terminaison du participe passé du verbe « prendre » au masculin singulier. Malgré la régularité de la conjugaison, l’homophonie entre « pris » et « prit » brouille souvent les repères. La terminaison en « -it » s’invite parfois à tort dans des phrases où seule la forme « pris » s’impose selon la norme grammaticale.
Cette hésitation s’observe aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, entraînant des erreurs récurrentes dans les courriers, les examens ou la communication professionnelle. La précision s’avère pourtant indispensable pour éviter les fautes les plus fréquentes de la langue française.
Une confusion fréquente en français : pourquoi « il a prit » semble correct
Le français ne manque pas de pièges. Parmi eux, la confusion entre « il a pris » et « il a prit » s’accroche de façon tenace. L’illusion est tenace parce que les deux formes se prononcent exactement de la même manière, et parce que la conjugaison du verbe « prendre » n’a rien d’intuitif. Ce verbe du troisième groupe, réputé indomptable, invite régulièrement à l’erreur, surtout à l’écrit.
Ce genre de faute surgit surtout à l’écrit, où « pris » et « prit » se disputent la place. « Pris », participe passé, toujours avec un « s », s’oppose à « prit », qui est la forme du passé simple à la troisième personne du singulier. Les oreilles, elles, ne font aucune différence : seule la relecture soigneuse permet de détecter l’erreur. Étudiant, professionnel, amateur de littérature : personne n’est vraiment à l’abri.
D’où vient cette confusion tenace ? Le passé simple, réservé à l’écrit, s’efface du quotidien au profit du passé composé. Les automatismes s’installent, la rédaction va vite, et la faute glisse sans crier gare. Le réflexe consiste aussi à reproduire le schéma d’autres verbes du même groupe, ce qui n’aide pas à clarifier la règle.
Pour mieux comprendre les causes de ces erreurs, voici quelques facteurs qui les favorisent :
- La vigilance baisse face à l’écrit : un coup d’œil trop rapide et l’accord passe à la trappe.
- Certains correcteurs automatiques passent à côté de cette subtilité et laissent passer la coquille.
- La grammaire française, truffée de subtilités, multiplie les embûches dès que l’on doute entre « pris » et « prit ».
Face à cette dérive fréquente, un seul remède : porter une attention accrue à l’orthographe, car elle reste un signe de sérieux et de crédibilité dans tous les écrits.
Quand le verbe « prendre » se conjugue-t-il avec « pris » ou « prit » ?
Entre « pris » et « prit », tout est affaire de contexte grammatical. Le verbe « prendre » change de forme selon le temps et la personne, et cette bascule réclame un œil attentif. Deux formes, deux emplois, pas d’alternative.
La forme « pris » s’emploie comme participe passé, le plus souvent avec l’auxiliaire « avoir ». Elle indique un acte terminé : « il a pris le train », « elle a pris une décision ». Ce temps, le passé composé, règne en maître dans les conversations et la majorité des textes courants.
À l’inverse, « prit » appartient au passé simple, troisième personne du singulier. Ce temps relève de la narration littéraire ou de contextes formels : « il prit la parole », « elle prit son manteau ». On ne l’entend jamais à l’oral. Ici, pas d’auxiliaire : la terminaison « -it » dit tout.
Pour clarifier l’usage, retenez bien ces points :
- « Pris » s’utilise comme participe passé, toujours accompagné d’un auxiliaire comme « a », « avait », « aura ».
- « Prit » s’emploie au passé simple, à la troisième personne du singulier, sans auxiliaire.
Le secret, c’est de bien repérer la structure de la phrase. L’auxiliaire fait toute la différence. Soyez attentif à la syntaxe, au contexte, et à la logique de l’énoncé pour ne pas vous tromper.
La règle expliquée simplement : comment distinguer le participe passé du passé simple
Le français ne laisse aucune place au hasard entre le participe passé et le passé simple. La différence est nette, mais l’erreur s’invite quand la mécanique de la langue se dérègle, à force de rapidité ou de doute.
Le participe passé « pris » s’emploie avec « avoir », dans le passé composé. Il traduit une action achevée, souvent en lien avec le présent ou ses conséquences : « elle a pris la parole ». Ce temps, omniprésent, structure nos échanges quotidiens et professionnels.
À l’inverse, « prit » n’apparaît qu’à la troisième personne du singulier du passé simple, sans auxiliaire. On le croise surtout dans les romans, les récits historiques, ou certains articles qui privilégient le style narratif : « il prit la fuite ». Ce temps, rare aujourd’hui en dehors de la littérature, imprime une marque stylistique forte.
| Forme | Temps | Emploi | Exemple |
|---|---|---|---|
| pris | participe passé | avec auxiliaire avoir | Nous avons pris le train. |
| prit | passé simple | sans auxiliaire, récit littéraire | Elle prit la décision. |
Pour ne pas se tromper, vérifiez la présence ou non de l’auxiliaire, et tenez compte du type de texte. Un réflexe : relire la phrase, isoler le verbe, repérer l’auxiliaire éventuel. Cette méthode écarte définitivement le doute sur l’accord du verbe.
Des exemples concrets pour ne plus jamais hésiter à l’écrit comme à l’oral
Quelques situations illustrent clairement la différence et permettent d’ancrer la règle. Pour chaque phrase, posez-vous la question : l’auxiliaire « avoir » est-il présent ? Si la réponse est oui, optez systématiquement pour « pris ».
- Écrit correct : « Elle a pris une décision difficile. »
- Erreur courante : « Elle a prit une décision. »
- Usage littéraire : « Il prit le train pour Paris. » (passé simple, sans auxiliaire)
À l’oral, difficile de repérer la faute : la prononciation reste identique. Mais à l’écrit, l’erreur saute aux yeux d’un correcteur rigoureux. Certains outils, comme MerciApp, détectent instantanément ce type d’erreur. Il suffit de relire : « Nous avons pris le chemin le plus court. » Jamais « Nous avons prit ».
| Formulation | Correct | Incorrect |
|---|---|---|
| Avec auxiliaire | Il a pris la parole | Il a prit la parole |
| Sans auxiliaire (littérature) | Elles prirent la fuite | – |
Dans la vie de tous les jours, dans les courriels professionnels ou les échanges administratifs, c’est la forme « pris » qui s’impose presque toujours. Seul le récit littéraire ou la narration formelle autorisent « prit ». Même logique pour les expressions construites avec « prendre » : « avoir pris une décision », « avoir pris le train ». Les synonymes comme « saisir » ou « empoigner » suivent le même schéma de conjugaison.
Rien de tel qu’une règle claire, quelques exemples bien choisis et un réflexe de vérification pour éviter la faute qui traîne. La langue française ne pardonne pas l’erreur ici, mais une fois la différence intégrée, plus de faux pas possible. Entre « pris » et « prit », il n’y a qu’un pas… et un auxiliaire.